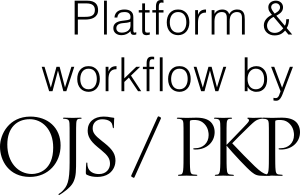Les pronoms démonstratifs neutres du français devant les subordonnées de type relatif
DOI :
https://doi.org/10.31261/NEO.2023.35.15Mots-clés :
Demonstrative, relative, cleft, focusingRésumé
Ce travail examine le fonctionnement des pronoms démonstratifs neutres du français devant les subordinnées de type relatif. Il montre les différences de comportement de ce par rapport aux formes cela, ceci, ça , en détaillant les modes d'acquisition du sens et de la référence de ces termes, et établit que ce est un pronom défini non démonstratif, avec des évolutions dans les usages.
Références
Apothéloz, D. (2018). Examen d’une famille de constructions : les constructions identificatives. Scolia 32, 13–41.
Corblin, F. (1987a). Ceci et cela comme formes à contenu indistinct. Langue française 75, 75–93.
Corblin, F. (1987b). Indéfini, défini et démonstratif. Droz.
Corblin, F. (1990). Les groupes nominaux sans nom du français. Dans G. Kleiber & J. E. Tyvaert (éds), L’anaphore et ses domaines. Recherches Linguistiques 14 (63–80). Centre syntaxique de l’Université de Metz.
Cornish, F. (2017). SN démonstratifs et anadeixis : sens « spatial » ou valeurs tributaires d’une stratégie pragmatique potentielle ?. Journal of French Language Studies 27, 215–239.
Diessel, H. (2014). Demonstratives, Frames of Reference, and Semantic Universals of Space. Language and Linguistics Compass 8(3), 116–132.
Gary-Prieur, M.-N. (1998). La dimension cataphorique du démonstratif. Étude de constructions à relative. Langue française 120, 44–50.
Hirschbühler, P. & Labelle, M. (1990). Celui comme noyau de syntagme nominal. Travaux de linguistique 20, 109–122.
Kęsik, M. (1989). La cataphore. PUF.
Kleiber, G. (1984). Sur la sémantique des descriptions démonstratives. Linguisticae Investigationes 8(1), 63–85.
Kleiber, G. (1998a). Des cerisiers, ça fleurit au printemps : une construction bien énigmatique. Dans E. Werner, R. Liver, Y. Stork & M. Nicklaus (éds), Et multum et multa (95–112). Gunter Narr.
Kleiber, G. (1998b). Au générique : tout ça pour ça. Dans J. Pauchard & J. E. Tyvaert (éds), La variation (domaine anglais). La généricité (195–231). Presses Universitaires de Reims.
Kleiber, G. (2004a). Anticipation, mémoire et démonstratifs cataphoriques. Dans R. Sock & B. Vaxelaire (éds), L’anticipation à l’horizon du présent (221–236). Pierre Mardaga.
Kleiber, G. (2004b) Sémantique, référence et discours : le cas des démonstratifs cataphoriques spécifiques. Dans A. Auchlin et al. (éds), Structures et discours. Mélanges offerts à Eddy Roulet (231–245). Nota Bene.
Maillard, M. (1974). Essai de typologie des substituts diaphoriques. Langue française 21, 55–71.
Muller, C. (2003). Naissance et évolution des constructions clivées en « c’est…que… » : de la focalisation sur l’objet concret à la focalisation fonctionnelle. Dans P. Blumenthal & J. E. Tyvaert (éds), La cognition dans le temps (100–120). Niemeyer.
Muller, C. (2018). L’emploi de ce dans les reprises de contenu propositionnel. Scolia 32, 117–138.
Muller, C. (2020). Le ce antécédent des constructions de type relatif : un pronom démonstratif ?. Langue française 205, 101–119.
Muller, C. (2023). Les démonstratifs neutres du français en cataphore d’une subordonnée complétive. Linguisticae Investigationes 46(1), 18–40.
Riegel, M., Pellat J. C. & Rioul, R. (2009). Grammaire méthodique du français. PUF.
Sandfeld, K. (1977(1936)). Syntaxe du français contemporain. Les propositions subordonnées. Droz.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Les propriétaires des droits d'auteur du texte soumis sont l'auteur et l'éditeur. Le lecteur a le droit d'utiliser les documents pdf selon les termes de la licence internationale Creative Commons 4.0 : Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Vous pouvez copier et redistribuer le matériel sur tout support ou dans tout format et remixer, transformer et utiliser le matériel à toutes fins.
1. Licence
La Maison d'édition de l'Université de Silésie offre un accès libre et immédiat au contenu de ses revues sous la licence Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Les auteurs qui publient dans ce journal conservent tous les droits d'auteur et acceptent les termes de la licence CC BY-SA 4.0 susmentionnée.
2. Déclaration d'auteur
L'auteur déclare que l'article est original, qu'il a été écrit par l'auteur (et les co-auteurs), qu'il n'a pas été publié précédemment, qu'il ne contient pas de contenus illégaux, qu'il n'enfreint pas les droits d'autrui, qu'il fait l'objet des droits d’auteur qui appartienent exclusivement à l'auteur et qu'il est libre de tout droit de tiers, et que l'auteur a obtenu toutes les autorisations écrites nécessaires pour citer d'autres sources.
Si l'article contient du matériel d'illustration (dessins, photographies, graphiques, cartes, etc.), l'auteur déclare que les œuvres indiquées sont les siennes, qu'elles ne portent pas atteinte aux droits de quiconque (y compris les droits personnels, par exemple le droit de disposer de son image) et qu'il en détient tous les droits patrimoniaux. Il met les œuvres ci-dessus à disposition comme partie d'un article sous la licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".
ATTENTION : Sans déterminer la situation juridique du matériel d'illustration et joindre les consentements appropriés des propriétaires des droits d'auteur, la publication ne sera pas acceptée pour un travail éditorial. En même temps, l'auteur déclare prendre toute la responsabilité en cas de données incorrectes (y compris en ce qui concerne la couverture des frais encourus par la Maison d'édition de l'Université de Silésie et les réclamations financières de tiers).
3. Droits des utilisateurs
En vertu de la licence Creative Commons Attribution, les utilisateurs peuvent partager (copier, distribuer et transmettre) et adapter (remixer, transformer et construire à partir du matériel) l'article à n'importe quelle fin, à condition de le marquer de la manière spécifiée par l'auteur ou le concédant de licence.
4. Co-auteurs
Si l'article a été cosigné avec d'autres auteurs, la personne qui soumet ce formulaire garantit qu'elle a été autorisée par tous les co-auteurs à signer cet accord en leur nom et s'engage à informer ses co-auteurs des termes de cet accord.
En tant que l'auteur du texte proposé, je déclare qu'en cas de retrait du texte du processus de publication non convenu avec le comité de rédaction et/ou l'éditeur de la revue par moi-même ou de son renvoi parallèle à un autre éditeur, je m'engage à couvrir tous les frais encourus par l'Université de Silésie dans le cadre de la procédure de ma soumission (y compris, entre autres, les frais de publication des revues).